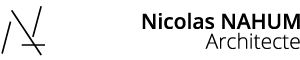CRISE URBAINE OU CRISE SOCIALE?
Article paru dans la rubrique DEBATS du journal LE MONDE daté du 31 janvier 1998
Nous sommes témoins, depuis peu, d’un glissement sémantique : ce qui était naguère appelé « crise sociale » se dit désormais « crise urbaine », les violences sociales sont des violences urbaines et la politique de la ville tient lieu de politique sociale. Il semble important de comprendre cette dérive si l’on désire s’attaquer aux causes des désordres plutôt qu’aux conséquences. Dans un article paru le 13 janvier dans les colonnes du Monde (« Vivre mieux dans la ville »), Martine Aubry s’appuie sur un réquisitoire contre la cité moderne pour exposer les idées qui doivent orienter la politique de la ville. Elle assimile la forme des quartiers aux désordres qu’ils abritent, allant jusqu’à leur attribuer une capacité d’intégration sociale qu’ils auraient aujourd’hui perdue. Conférer un tel pouvoir à la morphologie des villes, c’est oublier qu’elles sont aussi le résultat des actions de leurs habitants.
Si les quartiers en difficultés sont perçus par les politiques comme « un concentré de tous les maux« , ils n’en sont pas pour autant la cause. C’est bien la crise économique et le chômage qui ont suscité le regroupement des populations fragiles et non l’inverse. La crise sociale se loge ou elle peut, là dans les locaux de l’Ecole Normale Supérieure, ailleurs dans quelques cités confinées dans les banlieues, dans les centre-ville désaffectés, dans des favelas, des ghettos ou des squats.
Me Aubry annonce l’intention courageuse s’utiliser la construction des nouveaux équipements comme moteur de la transformation de la ville. Si utile soit-elle, cette proposition ne palliera pas à elle seule les déficiences de la promotion sociale. L’amalgame entre crise sociale et crise urbaine ne peut pas rassurer les populations en mal d’avenir.
D’ailleurs, Mme la ministre ne nous dit pas comment l’aménagement des villes serait susceptible de concilier la sécurité avec la mixité qu’elle appelle de ses vœux. La contrainte sécuritaire pousse les habitants de la périphérie urbaine à se réfugier dans l’isolement relatif des quartiers résidentiels rétifs au brassage social. A l’extrême, nulle part on ne se sent plus en sécurité que dans une caserne ou un hôpital. L’isolement entretient la peur et donne l’illusion de la sécurité.
L’analyse de Martine Aubry repose sur un cri de désamour pour la ville mais le diagnostic sur les raisons de l’échec supposé de la cité moderne est absent. C’est que celle-ci recouvre une quantité de situations différentes qui se prêtent mal aux généralisations. Elle met aux prises les principaux acteurs du monde contemporain, pouvoirs publics, investisseurs, entreprises, professionnels et habitants. En cela, elle fournit un modèle utile à l’analyse et à l’action politiques. Seule une réflexion sur les mécanismes du pouvoir permettrait d’agir sur la ville autrement que par réaction a posteriori aux erreurs précédentes.
La politique de la ville, surtout depuis la mise en place de la décentralisation, est devenue très largement la responsabilité des collectivités locales et de leurs services. Chacun sera sensible, spécialement en temps de crise, à la façon dont elles exercent leurs prérogatives. Or ni la question de la formation des maires, ni celle de l’importance croissante des administrations n’est vraiment posée. Ce qui constituerait la ville de droit commun, l’urbanisme ordinaire n’est pas pris en compte.
Ne voit-on pas que c’est justement une interprétation trop spécifiquement sociale de l’urbanisme qui a conduit à l’édification des quartiers que Martine Aubry honnit aujourd’hui ? De même, ne voit-on pas qu’une approche trop exclusivement technique conduit à faire approuver des infrastructures sur le seul motif de leur nécessité, alors que les modalité compensatoires d’intégration sont inexistantes ou mal pensées ? Les amoureux de la vile, ceux qui s’inquiètent de la frilosité de nos concitoyens, s’interrogeront sur nos archaïsmes et se demanderont par exemple, pourquoi un maire peut choisir pour d’autres l’architecture la plus univoque, comment un conseil général peut imposer le passage d’infrastructures les plus contestables et, dans le même temps, pourquoi un simple particulier ne peut donner libre cours à ses envies pour la réalisation d’un pavillon que pourtant, il habitera.
La République, c’est la substitution à traves la représentation et la délégation des prérogatives mais pour quel dessein ? Il ne peut s’agir d’appliquer à la ville de demain le désir de la ville d’hier. Puisqu’elle procède d’un grand nombre de volontés et de besoins antagonistes, la ville met à l’épreuve les acteurs et leurs capacité de juger. Il s’agit d’arbitrer pour définir les besoins, pour orienter les marchés et libérer les actions individuelles. Tous s’accorderont à reconnaître que ce n’est la ni la vocation naturelle d’une administration, ni la prérogative exclusive d’un élu qui s’arroge de ce seul fait l’intégralité de la décision.
Seule une application inspirée de la démocratie participative peut rendre aux habitants de nos villes un intérêt apaisé, une confiance attentive et un désir partagé, touts composantes nécessaires pour que dans ce creuset s’élabore une ville qui nous soit aimable.